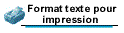Mis à jour le
mardi 21 novembre 2000
LE symbole ne pouvait être plus fort : sa mère
est de Sarajevo. Petite, elle lui racontait la douceur de sa
ville : l´appel du muezzin, les psaumes en
ladino(le judéo-espagnol), les cloches de l´église.
Amira Hass vient de loin, de là-bas. Si elle est devenue la
première journaliste israélienne en poste à Gaza, chez ces
Palestiniens si inquiétants, si étrangers aux Israéliens,
c´est aussi parce qu´elle a hérité de sa mère quelque chose de
la solidarité « multiethnique » des femmes de
Sarajevo.
Depuis 1993, elle est « correspondante israélienne
en Palestine » du quotidien Ha´Aretz.
« Pour comprendre et expliquer, il faut être à
l´intérieur. » A ce jour, elle est restée la seule.
Sept ans déjà qu´elle raconte l´occupation, les punitions
collectives, les fouilles, les jours sans fin de bouclage ou
de couvre-feu ; les mères qui cherchent du lait pour les
enfants, quand il est interdit de sortir ; les
travailleurs empêchés de gagner leur vie quand le permis de
sortie des territoires n´est pas renouvelé ; ceux
travaillant au noir en Israël, accidentés du travail et
aussitôt renvoyés sans un sou. Et les mille petites humiliations
qui sont le lot de l´occupé soumis à l´occupant, celles qui,
accumulées, engendrent le désespoir et la révolte.
Et les mille petites humiliations
qui sont le lot de l´occupé soumis à l´occupant, celles qui,
accumulées, engendrent le désespoir et la révolte.
Sept ans durant, elle décrit aussi les colons dans leurs
pavillons, à deux pas des camps de réfugiés. Et les attentats,
les appels au djihad dans les mosquées, la peur des soldats.
La lutte des organisations non gouvernementales (ONG)
palestiniennes contre les violations des droits de l´homme
– par les Israéliens et par l´Autorité palestinienne. La
haine ou la détermination des jeunes, la tristesse désabusée
des intellectuels, l´espoir d´un peuple, enfin, d´en finir
avec cette vie-là. « La Palestine, dit-elle, ce
n´est pas l´horreur tchétchène, mais depuis trente-trois ans
c´est un apartheid, et l´accord d´Oslo n´y a rien
changé. » « Amira nous oblige, dit le directeur
d´Ha´Aretz, Hanoch Marmari, à ne pas pouvoir
détourner les yeux. »
A Gaza, ses premiers contacts ont souvent été des
défenseurs des droits de l´homme, ceux qui refuseront,
ensuite, des boulots « pépères » dans
l´administration palestinienne. Au début, l´armée israélienne
– « habituée aux
journalistes-Pravda » – ne supporte pas ses
reportages. « Tu déranges. Donc tu fais du bon
travail », lui dit son rédacteur en chef. Tsahal a dû
s´habituer à sa présence gênante. En 1998, elle suit, avec un
photographe, des colons qui attaquent des paysans
palestiniens. Les colons leur tirent dessus. Elle informe
aussitôt le porte-parole de l´état-major. L´armée ne fera pas
état de l´incident. « Depuis, au sujet des colons, je
ne crois plus un mot des communiqués militaires. »
Elle se méfie, aussi, de la « martyrologie » des
Palestiniens, dont « ils ont un sens très
poussé ».
La plupart du temps, elle raconte la vie des simples gens.
Et quelquefois, elle se « lâche » dans un article en
pages Opinions de son quotidien. Comme récemment, le
1er novembre. « Ah ! Qu´il est naturel, pour
nous Israéliens, que 40 000 personnes soient
soumises au couvre-feu intégral durant plus d´un mois à Hébron
pour protéger la vie et le confort de 500 Juifs. Que les
écoliers y soient enfermés nuit et jour quand les enfants
juifs se promènent librement. Qu´une mère palestinienne doive
supplier le soldat de l´autoriser à aller chercher un
médicament pour son fils asthmatique. Qu´il est évident que
les snipers israéliens ouvrent parfois le feu sur des
habitations, que les colons détruisent les vitres et les pneus
des voitures de Palestiniens dans le seul but de montrer qui
est le boss ici. Qu´un Palestinien ait besoin d´un permis
spécial pour se déplacer à Jérusalem ou à Gaza quand les Juifs
roulent librement sur des routes construites spécialement pour
eux sur des terres de Palestiniens expropriés. Qu´en été l´eau
soit rationnée pour les Palestiniens, quand les colons en ont
à satiété. Ah ! Qu´il est facile de voir les Palestiniens
comme des gens cruels et violents, et d´ignorer notre propre
cruauté depuis trente-trois ans. »
Avant de déménager à Ramallah, en 1998, Amira Hass a pris
le temps d´écrire un livre : Boire l´eau de la mer à
Gaza. « Le portrait d´une tragédie », commentera
l´historien israélien Tom Segev. « Peu d´écrivains,
jugera The Economist, ont exposé l´emprisonnement
quotidien et le danger de la vie à Gaza avec la véhémence et
la précision de Mlle Hass. » En Israël comme en
Palestine, le titre se comprend instantanément. En hébreu,
« va au diable ! » se dit communément
« va à Gaza ! » En arabe, on dit :
« Va donc boire l´eau de la mer à Gaza ! »
Gaza, c´est l´enfer.
A-T-ELLE PEUR ? « Ça m´arrive, mais
beaucoup moins qu´on ne l´imagine. » Lorsque, en
1994, une conductrice israélienne est assassinée par un des
travailleurs palestiniens qu´elle transportait, son directeur
l´appelle : « Il est temps de partir. »
Elle a refusé. Elle commençait à se faire « un
réseau : des gens formidables, chaleureux. Plus je vivais
dans les territoires, plus je me sentais en sécurité. Les
Israéliens ne connaissent pas les Palestiniens ».
Pour ses compatriotes, vivre seule à Gaza est
« une folie ». Elle reçoit toujours des
lettres d´insultes. Quelques lecteurs résilient leur
abonnement à cause d´elle. D´autres considèrent qu´elle est
« l´honneur de sa profession ». Beaucoup la
traitent de« belle âme ». Une « belle
âme », en hébreu, c´est quelqu´un chez qui une vaine
morale cache la forêt de la réalité politique. La réponse
fuse : « Ça me va. Je ne crois pas qu´une bonne
politique puisse être amorale. »
Les Palestiniens, eux, la trouvent souvent
« bizarre ». En ville, des dizaines de gens
la reconnaissent. « Hé, Amira, salut ! »
D´autres la regardent toujours avec suspicion. Mais beaucoup
l´aiment : elle est leur voix auprès de ses frères
israéliens. Etonnamment, c´est avec des hommes qu´elle a créé
les liens les plus forts. « Souvent, ils ont travaillé
en Israël ou ont appris l´hébreu en prison. L´Israélien, pour
eux, c´est l´oppresseur, mais pas un adversaire
imaginaire. » Parmi ceux qui se battent aujourd´hui,
presque tous, quand on parle tranquillement avec eux, évoquent
à un moment cet « autre » Israélien. Ce restaurateur
« très sympa, même dans les pires moments »,
chez qui l´un a travaillé. Cet universitaire avec qui un
enseignant échange toujours des e-mails. Les femmes
palestiniennes, elles, « ne connaissent des Israéliens
que les soldats et les colons. La méfiance est plus
grande ».
De l´Autorité palestinienne Amira connaît tout le
personnel. Mais, par nature et expérience, les institutionnels
ne la fascinent pas, ni du côté israélien ni de l´autre.
« J´ai toujours pensé que l´histoire est plus la
chronique de la vie des gens que celle des régnants et de
leurs rites. » Elle a peu d´illusions sur la
propension démocratique de l´Autorité : ses articles sont
souvent traduits dans la presse palestinienne, jamais ceux
jugés dérangeants. Deux fois, elle a été convoquée par la
police palestinienne : « Ça devient trop
dangereux pour vous, vous devriez partir. » Chaque
fois, ces « conseils » intervenaient après un
article sur la corruption de l´Autorité ou son irrespect des
droits de l´homme. Les ONG se sont mobilisées en sa faveur. Le
jour où deux soldats israéliens ont été lynchés dans sa ville,
un député palestinien l´a appelée : « Si tu ne te
sens pas en sécurité, tu viens habiter chez moi. »
Elle est restée dans son HLM de Ramallah.
Des anecdotes, elle en a à la pelle. « En 1994,
j´obtiens la première interview à un journal israélien d´un
dirigeant islamiste, Hani Abed, raconte-t-elle. On monte
dans un taxi, il me dit : »Auriez-vous imaginé vous
retrouver un jour assise près d´un chef du Hamas ?« Je
lui ai rétorqué : »Et vous, direz-vous à votre épouse que
vous avez fait le trajet près d´une autre femme, une
Israélienne, une athée en plus ? Le diable, quoi !«
Il a éclaté de rire. » Depuis, Hani Abed est un de ses
nombreux « contacts ».
Le soir, chez elle, le téléphone sonne vingt, trente fois.
Une Israélienne demande comment faire pour qu´un universitaire
palestinien sorte de son village « bouclé ».
« Je ne sais pas, voyez si Yael Dayan peut
intervenir. » Une Palestinienne de Jérusalem :
« On veut nous expulser ! » « Depuis
qu´un article a fait annuler une procédure d´expulsion,
explique Amira, ils croient que je suis le Bon Dieu. »
Des villageois de Harès (Cisjordanie) : « Des
colons nous ont coupé l´eau et l´électricité, et nous tirent
dessus. » Elle téléphone à l´armée. Le porte-parole
de Tsahal rappelle une heure après : « Oui, il y
a eu des affrontements. Non, les colons n´ont pas tiré. Nos
soldats l´ont fait pour ramener l´ordre. » « Il est
23 heures, c´est loin d´ici, les routes sont bloquées.
Allez savoir la vérité », s´exclame Amira.
Pourquoi ce métier, ces risques ? Elle est là, une
femme de quarante-quatre ans, l´allure juvénile, le visage
charmant, un éternel foulard autour du cou. « Parce
que, lâche-t-elle, je suis une enfant de la
Shoah. »La Shoah, ce n´est absolument pas une
analogie avec ce que vivent les Palestiniens. Le fait même de
comparer leur souffrance à celle des juifs sous le nazisme lui
semble une incongruité. « Non, la Shoah m´explique
moi. J´ai cette blessure, cette propension à l´échec et cette
sensibilité à toute déshumanisation qui est la marque de
certains enfants de rescapés. Je ne sais pas si vous pouvez
comprendre. » Elle ajoute que ses parents, résistants
communistes durant la guerre, sont indissociables de son
destin. Son père, survivant d´un ghetto « liquidé »
de Roumanie. Sa mère, la Sarajevienne, déportée à Bergen
Belsen. De leur communisme il ne lui reste plus grand-chose.
Mais ils lui ont transmis pour l´éternité le refus de
l´indifférence et le sens de la résistance. Sa résistance à
elle, c´est l´écriture.
Deux souvenirs marquent sa jeunesse. Celui que sa mère lui
a raconté, d´abord, arrivant à Bergen Belsen, après dix jours
dans un wagon à bestiaux : « Des femmes
allemandes regardaient, muettes, les déportés partant vers le
camp. » L´autre est un film de l´Israélien Haïm
Gouri, Le 81e Coup. On y voit le ghetto de
Varsovie en flammes et, en arrière-plan, la grande roue d´un
lunapark. Des Polonais s´amusent. Dans les deux cas, le même
syndrome, celui de l´observateur non concerné. Amira Hass sait
depuis l´adolescence que cette posture lui est
insupportable : « A cause de cette mémoire,
quand 40 000 personnes sont parquées chez elles
un mois comme des animaux, j´en ai la chair de
poule. »
Politiquement, elle n´a jamais été gauchiste. « Les
débats sur le droit d´Israël à exister, pfou… Pour moi, après
la Shoah, Israël existe, c´est tout. » « Je suis,
se définit-elle, culturellement juive, sociologiquement
israélienne. » Israélienne paradoxale et écorchée
juive. Elle sait que, chez la plupart de ses compatriotes et
des juifs qui s´identifient à eux, la mémoire de l´horreur
« unique » qu´est la Shoah renforce la crispation
ethnique. Simplement, cette mémoire produit chez elle l´effet
inverse.
« Au début, j´étais convaincue que si je montrais
par le menu la réalité de l´occupation, l´opinion se
réveillerait. J´en suis revenue. » Toujours se
souvenir : elle n´écrit pas pour les
Palestiniens – « Les gens croient que je
m´identifie à eux, c´est idiot, je suis Israélienne ».
Non, elle écrit pour les siens. Elle voudrait tant
qu´enfin « nous nous voyions tels que nous
sommes ». Mais le déni du malheur causé à l´autre,
dans lequel les Israéliens se barricadent, déni aujour-d´hui
aggravé par la peur que suscite l´Intifada, lui paraît trop
puissant.
PARFOIS, pourtant, son travail ne lui semble pas
inutile. Le 31 octobre, une avocate israélienne des
droits de l´homme l´a appelée : « Bravo,
Amira ! Grâce à toi, l´armée a partiellement levé le
couvre-feu à Hébron. » Le matin, elle avait publié
dans Ha´Aretz un effroyable reportage sur le sujet,
traduit dans la version anglaise du quotidien. Hanoch Marmari,
son directeur, confirme : les autorités sont extrêmement
sensibles à ce qui est lu à l´étranger.
Reste la politique. Très vite, après les accords d´Oslo,
elle a constaté la distorsion croissante entre la diplomatie
et le terrain. « Oslo a paralysé le camp pacifiste en
Israël. »Ah !, que la paix est jolie !«, avons-nous
pensé. Or la paix n´était pas belle. Mais les partisans d´Oslo
pensaient : »Qu´im-porte la colonisation qui continue,
les expropriations, les barrages multipliés sur les routes,
les bouclages, le chômage, puisqu´au bout nous aurons la
paix.« Aujourd´hui, nous payons le prix de cet
aveuglement. » Son directeur :
« L´immense mérite d´Amira est d´avoir montré,
obstinément, presque seule à le faire,
que parallèlement au processus de paix, le quotidien des
Palestiniens empirait. »
Le paradoxe de la paix d´Oslo, c´est que jamais
l´occupation ne fut aussi prégnante que durant ces sept
années. A relire les articles d´Amira, on mesure quel a dû
être, durant tout ce temps, son sentiment de solitude. En
mai 2000, Amira Hass a reçu d´un prestigieux jury
américain le Prix de la Liberté de la presse, pour son travail
en Palestine.
Sylvain Cypel
Le Monde daté du mercredi 22 novembre
2000