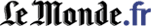Dans le torrent des explications visant à comprendre le
sous-développement ou l'absence de véritable intégration à
l'économie mondiale du Maghreb - exception faite de la
Tunisie -, du Proche et du Moyen-Orient avancées depuis le 11
septembre, on a très souvent négligé le rôle dévastateur qu'a joué
la rente pétrolière dans la plupart des systèmes économiques de ces
régions.
C'est assez étonnant car les dysfonctionnements induits par
l'existence d'une rente gazière ou pétrolière sont maintenant bien
connus. En fait, cette méconnaissance reflète le peu d'attention
portée à ces économies, auxquelles on s'intéresse uniquement en
raison de l'évolution du prix du pétrole ou des potentialités de ces
marchés.
A priori, l'existence d'une rente pétrolière importante
permettait à des pays comme l'Algérie, l'Arabie saoudite ou l'Iran
de ne pas être contraints par ce qui pénalise habituellement les
pays en voie de développement : le manque de capitaux.
L'objectif était alors d'utiliser cette manne pour bâtir des
économies modernes. Or la simple présence de cette rente a conduit,
outre à l'instabilité macro-économique propre à la dépendance
pétrolière, à des difficultés presque insolubles : l'Etat,
propriétaire de cette rente, l'a utilisée soit pour investir
directement, soit pour bâtir une industrie totalement protégée de la
concurrence, grâce à des subventions, des prêts spéciaux et une
protection douanière. L'essentiel des revenus budgétaires provenant
du pétrole, il n'a donc pas été nécessaire de favoriser le
développement d'un véritable système fiscal et même d'un système
bancaire efficace destiné à collecter l'épargne pour proposer des
crédits.
L'Etat étant le propriétaire unique de la rente pétrolière et le
système économique du pays ne fonctionnant que pour recycler cette
dernière, ces économies n'ont jamais connu l'émergence d'une
véritable classe entrepreneuriale nationale. Se sont plutôt
constituées des bourgeoisies pétrolières qui changent au gré des
régimes mais dont le principe de fonctionnement reste le même :
bâtir une relation spéciale avec l'Etat pour accaparer de manière
indirecte une partie de la manne.
L'industrie s'est retrouvée
sous-compétitive et très dépendante des importations de biens
d'équipement, ce qui se reflète dans la part ridiculement faible des
produits manufacturés dans les exportations. Ces économies
deviennent, en fait, surtout des économies où prospèrent le secteur
protégé et les services qui se développent uniquement via le
recyclage de la rente pétrolière.
L'Etat rentier pratique une politique de redistribution
clientéliste qui lui permet de construire des alliances politiques.
Il devient impossible, dans ces conditions, de mener une véritable
politique économique puisque le clientélisme prime sur toute autre
considération. La politique fiscale est ainsi "pervertie" car elle
sert surtout à favoriser certains réseaux. A cette fin, l'Etat
utilise des instruments qui ont l'immense avantage de se situer en
dehors du processus budgétaire classique et donc d'être
difficilement identifiables. D'où, souvent, de larges déficits du
secteur public.
Ces économies, très faiblement intégrées dans l'économie
mondiale, développent une vision consommatrice et faussée de la
modernité. Cette dernière apparaît surtout à travers l'acquisition
de la technologie importée et non grâce à une mise à niveau de
l'économie du pays par rapport au reste du monde (comme l'a fait la
Turquie, par exemple). Enfin, la gestion clientéliste de la rente
pétrolière conduit dans des pays à population importante comme
l'Algérie et l'Iran à de très fortes inégalités en matière de
revenus. De même, des économies basées uniquement sur le recyclage
de la rente pétrolière sont absolument incapables de créer un nombre
d'emplois suffisant pour faire face à une progression soutenue de la
population active. Le taux de chômage atteint près de 30 % en
Algérie et 14 % en Iran. De plus, une rente en cache souvent une
autre. L'Egypte, qui cumule rente pétrolière, rente touristique,
rente liée à la gestion du canal de Suez et rente de l'aide
étrangère, est atteinte de tous les maux.
Il faut aussi noter que l'ensemble de ces dysfonctionnements se
retrouvent dans la plupart des économies pétrolières, que ce soit en
Afrique, en Amérique latine ou en Asie centrale - les économies
d'Asie centrale qui basent leur développement futur sur la rente
pétrolière et gazière de la mer Caspienne s'exposent à des
lendemains qui déchantent. Il convient donc de relativiser les
thèses "culturalistes" qui visent à expliquer le sous-développement
et la faible intégration à l'économie mondiale du Maghreb et du
Proche et Moyen-Orient.
Malgré tout, il est effectivement très difficile pour un pays
disposant d'une manne pétrolière de réussir à diversifier son
économie. Le seul exemple véritablement probant est le Mexique (dont
le système fiscal reste toutefois sous-développé du fait du poids
des recettes pétrolières). Mais ce cas est, en partie, spécifique
car le Mexique a bénéficié des effets d'entraînement induits par la
proximité de l'économie américaine. La grande difficulté tient au
fait qu'il ne s'agit pas de mener des politiques classiques de
libéralisation économique, mais de favoriser l'émergence d'une
économie non pétrolière compétitive. Il faut, pour cela, tout un
éventail de réformes (promotion et libéralisation des secteurs ayant
un potentiel à l'exportation, séparation claire du public et du
privé, refonte des systèmes bancaires et fiscaux, enchaînement des
réformes politiques et économiques, etc.) dont l'ordonnancement est
complexe.
En plus des risques liés à des situations sociales explosives,
ces réformes se heurtent à la résistance des bénéficiaires de
l'économie de rente. En Arabie saoudite, il s'agit de réseaux mêlant
famille royale et marchands. En Iran, ils sont composés de bazaris
(grands marchands) et des fondations religieuses. En Egypte, ce sont
des réseaux politico-militaires alliés à quelques grandes familles
qui s'opposent aux réformes. La tâche apparaît donc difficile, et
l'on ne peut s'empêcher de penser que l'Union européenne doit jouer
ici un rôle déterminant.
Thierry Coville
chercheur associé au
département monde iranien (CNRS)