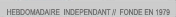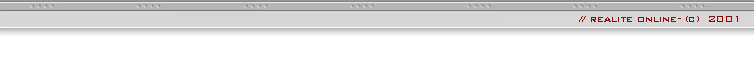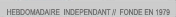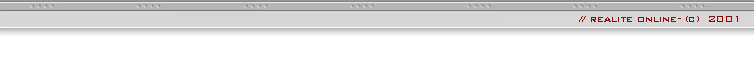|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Société |
 |
 |
 |
LE VOILE : Commandement divin ou simple tradition
?
L’interview accordée
par le Ministre des Affaires religieuses, M. Boubaker el Akhzouri, à
notre confrère Essabah (1) sur la non conformité du voile, dit
islamique, avec les traditions tunisiennes, continue d’alimenter une
polémique très vive dans nombre de médias arabes (surtout presse
écrite et journaux électroniques)... Si quelques articles ont
soutenu la position du ministre tunisien, la majorité l’a, par
contre, vilipendée. Cela va de la dénégation à M. el Akhzouri de
toute compétence en matière de religion au rappel des sourates du
Coran et des hadiths du Prophète qui “prouvent” l’erreur “flagrante”
du ministre.
Cette polémique nous interpelle à
plus d’un titre. Elle met le doigt sur des problèmes de société et
d’identité qui traversent tous les pays arabo-musulmans: comment
vivre sa foi aujourd’hui? La foi et la chariaâ (Loi religieuse)
sont-elles indissociables? La pudeur évolue-t-elle avec l’histoire?
Quel statut pour la femme?...
Ces problématiques sont
co-substantielles.Il est erroné de penser pouvoir les résoudre
séparément. Ceci ne nous empêche pas, toutefois, d’essayer
d’éclairer la question du voile et de la pudeur liée aux parties
honteuses (ÇáÚæÑÉ ) qui en découle.
“Sauf ce qui en
émerge”
Revenons aux origines.
L’interdit
vestimentaire est aussi vieux que la civilisation. Le corps est en
même temps objet et sujet du désir sexuel, donc de pouvoir
symbolique et social. Couvrir le corps de la femme était de ce fait
l’une des caractéristiques fondamentales des sociétés
traditionnelles patriarcales.
L’Islam n’a pas échappé à
cette loi. Le Coran a traité de l’interdit vestimentaire, seulement
les fondamentalistes nous présentent une vision tronquée des faits
historiques.
Pour accréditer facilement leur thèse : “le
voile est un commandement divin” ils recourent au verset 31 de la
sourate “La lumière” (ÇáäæÑ).
«— Dis aux croyantes de
baisser les yeux et de contenir leur sexe; de ne pas faire montre de
leurs agréments, sauf ce qui en émerge, de rabattre leur fichu sur
les échancrures de leur vêtement. Elles ne laisseront voir leurs
agréments qu’à leur mari, à leurs enfants, à leurs pères,
beaux-pères, fils, beaux-fils, frères, neveux de frères ou de sœurs,
aux femmes (de leur communauté), à leurs captives, à leurs
dépendants hommes incapables de l’acte, ou garçons encore ignorants
de l’intimité des femmes. Qu’elles ne piaffent pas pour révéler ce
qu’elles cachent de leurs agréments.
— Par dessus tout,
repentez-vous envers Dieu, vous tous les croyants, dans l’espoir
d’être des triompants...»(2).
Le commandement serait
celui-là : “de ne pas faire montre de leurs agréments, sauf ce qui
en émerge”.
Mais qu’est-ce qui émerge des agréments d’une
femme? C’est-à-dire quelles parties du corps sont licites pour un
regard étranger et quelles sont les parties honteuses ?
La
réponse des traditionalistes est la suivante : le visage et les
mains. Le reste du corps tombe sous le coup de l’interdit divin.
L’argument massue pour valider cette interprétation est le hadith
(dit) du Prophète qui stipule qu’après la puberté une femme ne peut
montrer que son visage et ses deux mains.
Restons dans le
contexte exégétique. Est-il vrai que cette interprétation fait
l’unanimité chez les ulémas?
Le célèbre fakih andalou Ibn
Rochd (petit-fils du grand philosophe du même nom, Averroès pour les
Occidentaux) a établi une compilation synthétique remarquable au
sixième siècle de l’Hégire (12ème siècle de l’ère chrétienne) de la
production du fikh (droit musulman) (3).
Quelles sont les
partis “honteuses” du corps féminin?
Ibn Rochd nous rapporte
que l’avis de la majorité des ulémas est que cet interdit recouvre
tout le corps de la femme sauf son visage et ses deux mains.
Soulignons, pour l’anecdote, que la plante des pieds fait, elle
aussi, partie de l’interdit. Pour Abou Hanifa la plante des pieds
n’est pas comprise dans les parties honteuses, par contre certains
pensent que la totalité du corps féminin est honteuse, y compris le
visage et les mains.
Tabari, le grand historiographe et
exégète (mort en l’an 310 de l’Hégire) rapporte dans son
encyclopédie exégétique (4) une tradition prophétique (toujours dans
le commentaire du verset 31 de la Sourate “La lumière”) qui sort des
parties honteuses la moitié de l’avant-bras féminin.
Pudeur et hiérarchie sociale
Mais au-delà de
toutes ces divergences de détails, Ibn Rochd et Tabari disent
clairement que ce qui “émerge des agréments d’une femme” sont les
parties qu’on montre habituellement en public. C’est donc une
question d’habitude sociale. Ibn Rochd souligne, à sa manière, cette
dimension de la coutume sociale: les parties honteuses de la femme
esclave sont autres. L’esclave peut, et selon certains doit, faire
la prière sans se couvrir la tête. Certains jurisconsultes vont
jusqu’à dire que les parties honteuses de l’esclave vont du nombril
aux genoux seulement. La raison invoquée est qu’on ne peut acheter
une marchandise cachée.
Mais le contexte social n’est pas
l’invention de ces savants, il est clairement indiqué dans le verset
31. La traduction de Jacques Berques est ici relativement imprécise.
Il traduit :
Ãæ äÓÇÆåä Ãæ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåã Ãæ ÇáÊÇÈÚíä ÛíÑ
Ãæáí ÇáÇÑÈÉ ãä ÇáÑÌÇá
par “aux femmes (de leur
communauté) à leurs captives à leur dépendants hommes incapables de
l’acte “ äÓÇÆåä ” (littéralement leurs femmes) traduit les femmes
qui sont sous leur tutelle ou autorité: c’est-à-dire les servantes
non esclaves ou les femmes, comme les hommes aussi, rattachés à une
tribu arabe (Mawali).
Quant à “ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåã ” rien ne
permet de le traduire par “leurs captives” mais plutôt “leurs
captifs”, comme l’explique longuement Tabari. La différence est de
taille : les parties honteuses varient en fonction du statut de la
“femme qui montre” et de “l’homme qui regarde”. Elles ne relèvent
pas de la nature de la féminité, comme le laissent entendre les
traditionnalistes d’aujourd’hui, mais de la nature des rapports
sociaux entre les deux sexes et d’une hiérarchie de la pudeur,
intimement liés à la hiérarchie sociale.
Spécificité de
la cause ou généralité de l’énoncé ?
Restons encore dans
le cadre de l’approche exégétique. Il est admis que les versets du
Coran sont “descendus” en fragments sur près de vingt-trois ans.
Souvent le fragment coranique, surtout à Médine, répond à une
situation particulière dite par les théologiens “Les causes de la
Révélation (descente)”.
Seulement, dès l’âge classique, les
docteurs de la Loi considéraient que l’important n’est pas la
spécificité de la cause mais la généralité de l’énoncé coranique.
Cela permettait, évidemment, de dépasser le contexte
particulier de la période prophétique et de généraliser la portée
des versets dit législatifs...
Certains réformateurs
modernes ont tenté de repenser cette attitude classique. Car il ne
s’agit pas, en fait, d’une libération des conditions particulières
de la période prophétique, mais de l’imposition d’une interprétation
figée selon les schémas sociaux et mentaux de l’époque fondatrice de
la naissance des sciences religieuses, c’est-à-dire
approximativement les trois premiers siècles de l’Hégire.
Ceci n’est valable, bien évidemment, que pour l’Islam
sunnite. Le Chiisme et les autres tendances minoritaires de l’Islam
ont connu un développement historique quelque peu différent.
Seulement cette réflexion n’est pas allée au bout de sa
logique. Pis encore, plus personne dans l’établissemnt religieux ne
remet en cause la légitimité des lectures anciennes pour notre
temps. Tout au plus on s’ingénie de choisir parmi la panoplie du
fikh traditionnel la fatwa (décret religieux) qui nous paraît la
mieux adaptée à notre société.
Société d’aujourd’hui,
monde d’hier
Revenons à notre question de départ :
comment définir les limites de la pudeur au 21ème siècle ? Quelles
seraient, d’un point de vue respectueux de la foi religieuse, les
parties honteuses ? Comment apprécier les changements énormes
survenus dans les mœurs et les comportements sociaux en terre
d’Islam depuis quinze siècles ?
Les fondamentalistes nous
disent de nous en tenir à la lettre du Coran. Mais voilà, le Coran,
à sa manière, a intégré les normes morales et sociales de son temps.
Il y a certes une interprétation majoritaire classique dans le monde
sunnite, mais elle n’est en aucun cas monolithique. On ne sait que
très bien que toute cette dimension historique des sciences
coraniques et islamiques n’intéresse pas les fondamentalistes
contemporains, car ils pensent avec raison que cela introduit des
doutes et le doute est l’ennemi principal du fondamentalisme.
Mais l’Islam est la religion et la culture d’un milliard et
demi d’humains. Le fondamentalisme, malgré toute l’agitation
médiatique, n’est qu’un courant minoritaire en terre d’Islam. Les
ulémas, les spécialistes de l’Islam, les intellectuels, les
décideurs et surtout les Musulmanes et Musulmans qui se sentent
concernés par l’actualité et l’avenir de leur religion sont en
droit, voire ont le devoir, de s’exprimer sur cette question
brûlante : peut-on vivre sa foi aujourd’hui, dans toutes ses
dimensions, comme l’ont vécu les premières générations de l’histoire
de l’Islam ?
Monsieur Boubaker Akhzouri n’est pas un mufti.
Son poste est politique et non religieux. Mais en quoi cela
l’empêcherait, lui, docteur en théologie, d’exprimer un point de vue
autorisé sur une question religieuse ? En tout cas l’essentiel de
ses pourfendeurs ont beaucoup moins de légitimité que lui. Faut-il
pour autant stigmatiser celles qui portent le voile par une
conviction religieuse ? et dont le nombre, contrairement à ce que
pense le ministre, s’accroit de jour en jour ? Il nous semble que
c’est le symbole qui est à stigmatiser et non les personnes.Mais ce
qui nous consterne, encore une fois, est le silence —parfois
complice, souvent gêné— des hommes de religion. Silence qui
participe à la prolifération de l’ignorance encouragée par certaines
chaînes satellitaires du Machrek arabe. C’est ce silence qui rend à
nos yeux encore plus méritoires les déclarations du ministre
tunisien.
(1) - Intermédialisée par notre consœur
Amel Moussa et publiée le 27 décembre dernier.
(2) - Coran,
essai de traduction par Jacques Berque. Cette traduction, malgré
quelques petites imperfections reste l’une des meilleures
disponibles en langue française.
(3) - “Bidayat al Majtahid
wa nihayat al Muktasid” d’Ibn Rochd.
(4) - “Jamii al Bayane
fi tafsir al quoraâne”.
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |

 |
 |
Tunis
 |
| Température |
| min. 6 øC - max. 9 øC |
 |
| Vent |
| 18.4 Km/H |
| Nord |
 |
| Relevé: 24/01 15:30 |
 |
 |
|
|
 | |
 |
| BVMTf |
| 1188.0300 0.4700 |
| Tunindex |
| 1671.5200 0.6700 |
| Change |
| Euro 1.6100 TND |
| Dollar 1.3330 TND |
| Date:
2006-01-24 | |
 |
| Pensez-vous que l’équipe nationale tunisienne de
football sera finaliste dans la CAN en Egypte
? |
|
| | |
 |